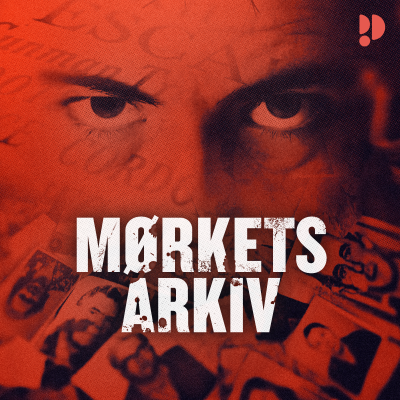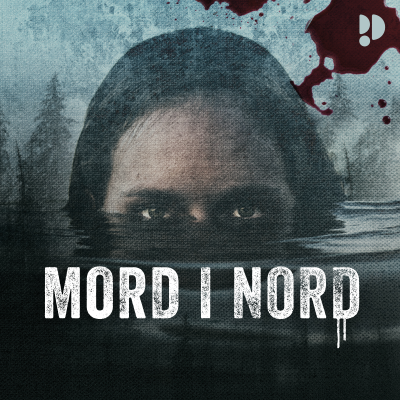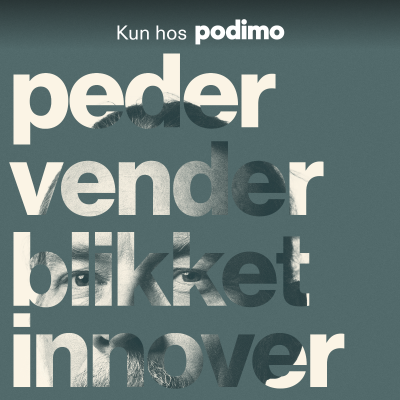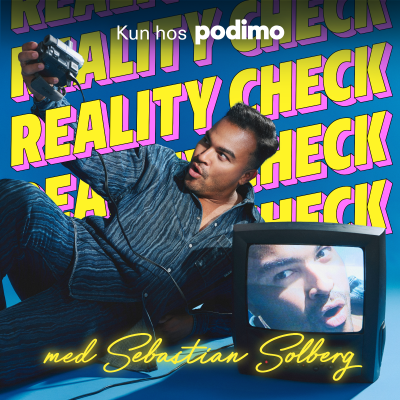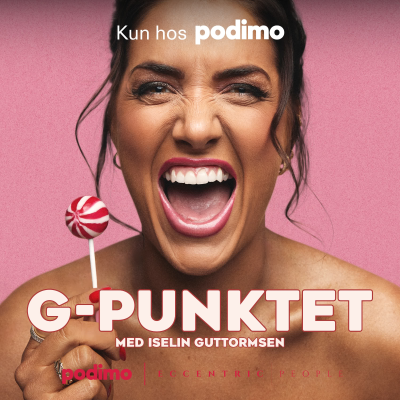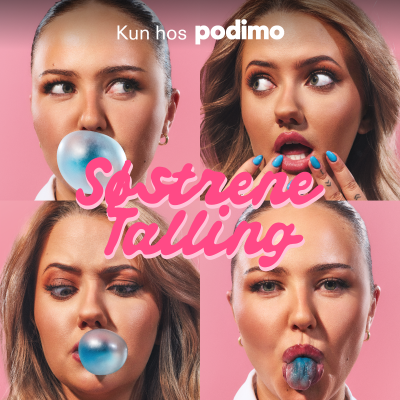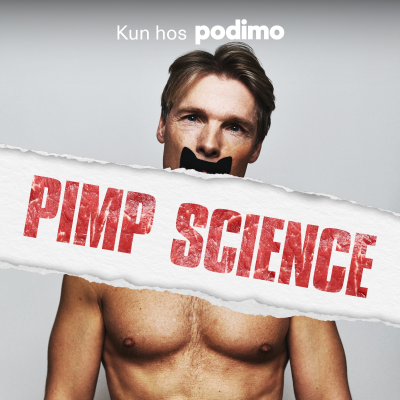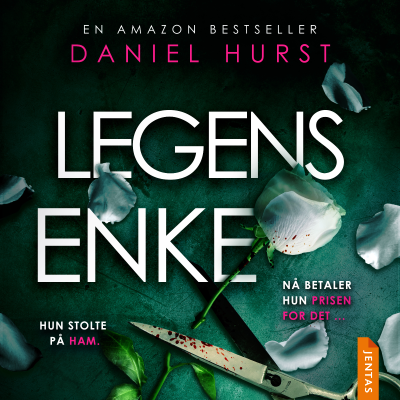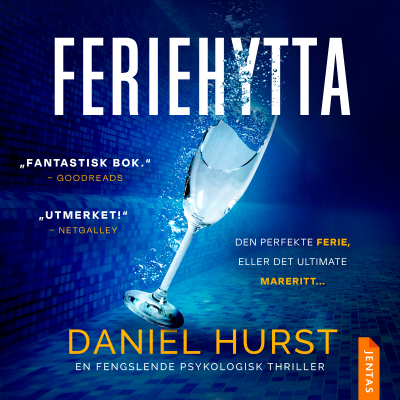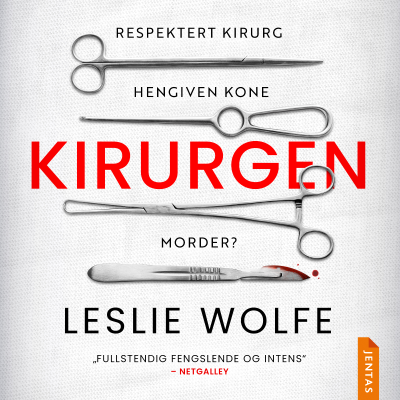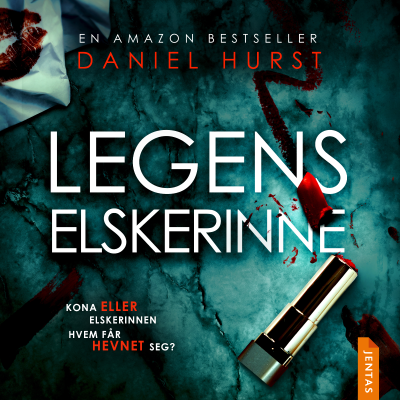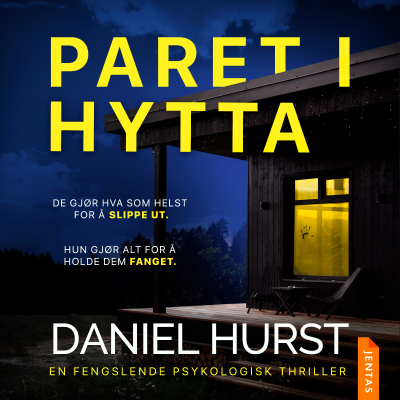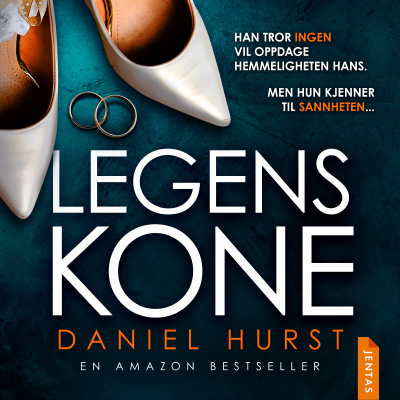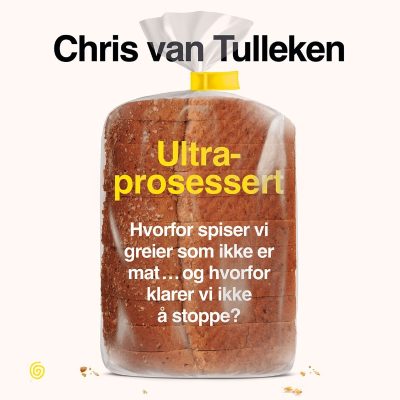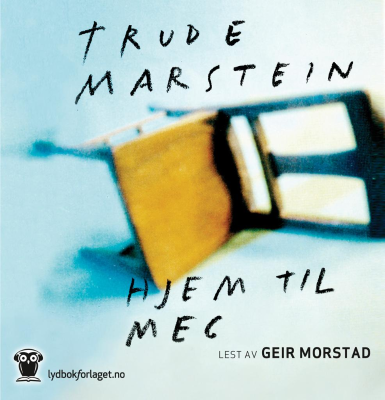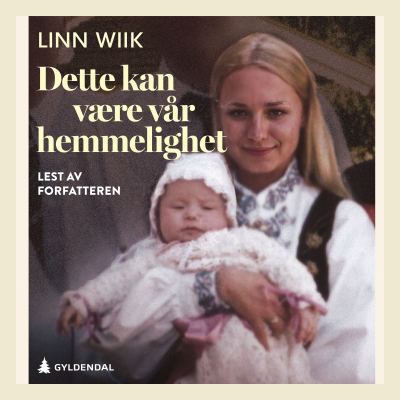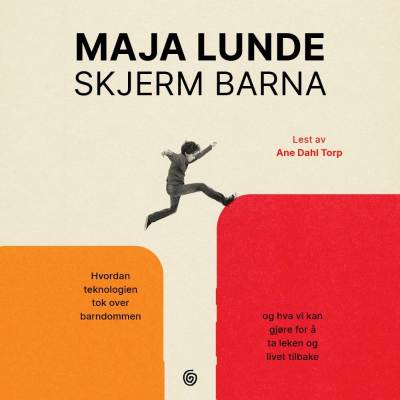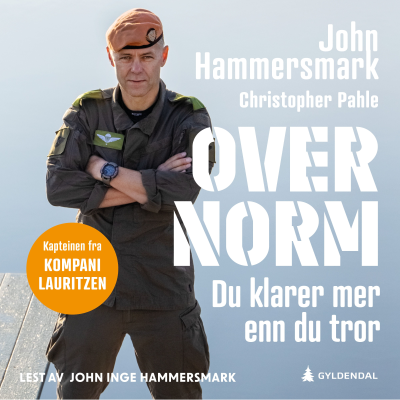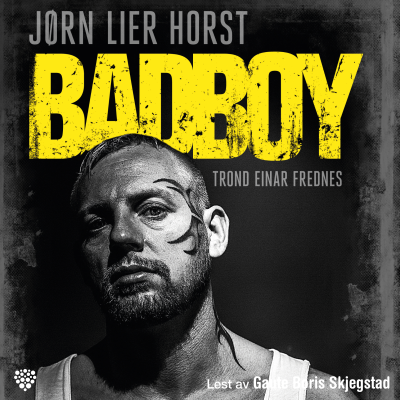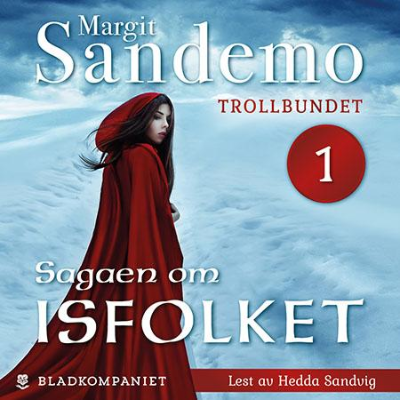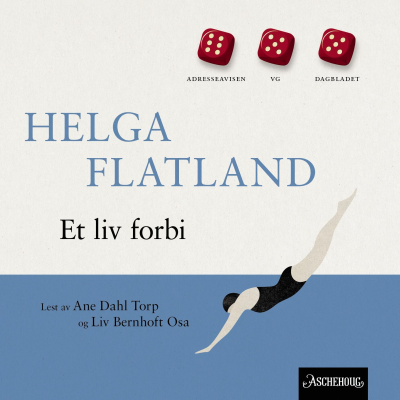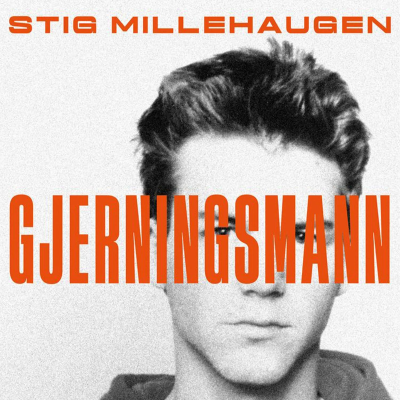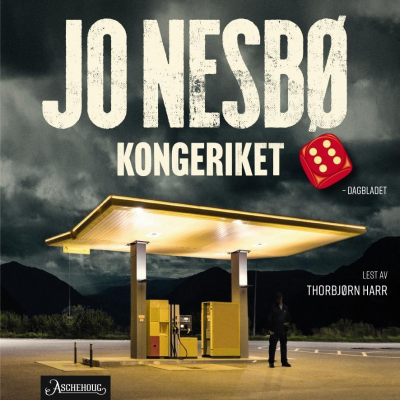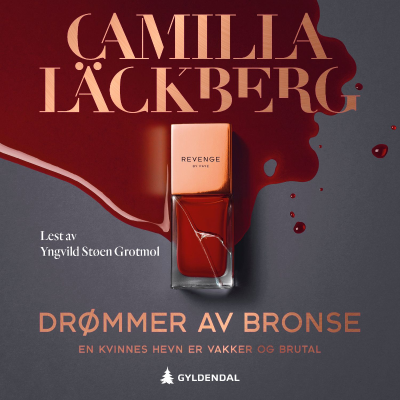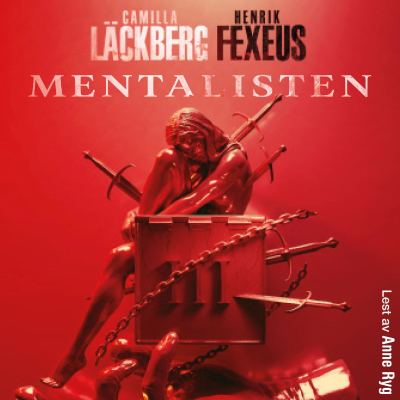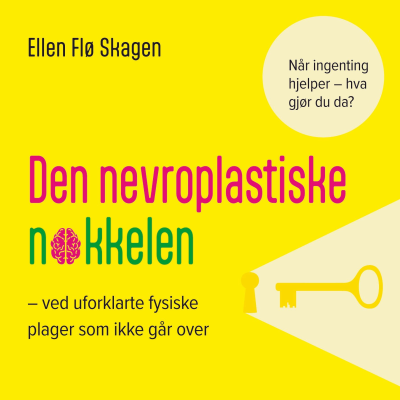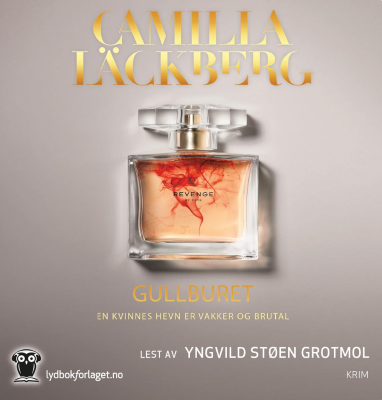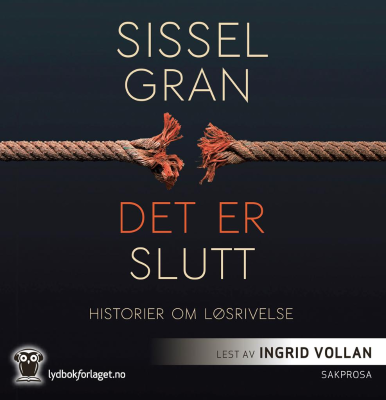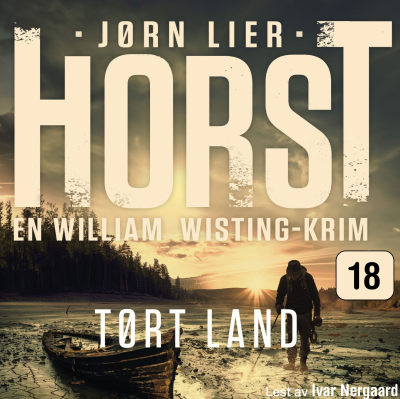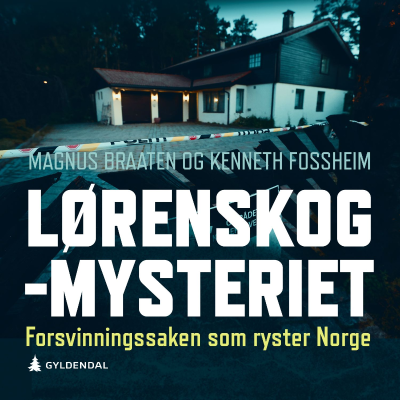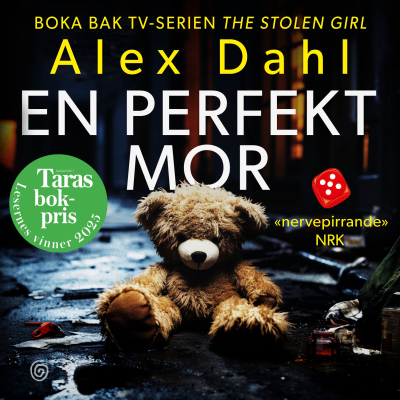Afrique, mémoires d'un continent
fransk
Nyheter og politikk
Prøv gratis i 14 dager
99 kr / Måned etter prøveperioden.Avslutt når som helst.
- 20 timer lydbøker i måneden
- Eksklusive podkaster
- Gratis podkaster
Les mer Afrique, mémoires d'un continent
Afrique, mémoires d'un continent explore l’histoire à travers les siècles et jusqu’à aujourd’hui. Historiens, universitaires et spécialistes expliquent et racontent, sans tabous et à rebours des clichés, comment le passé éclaire le présent. Une émission présentée par Elgas, en collaboration avec Delphine Michaud. Réalisation : Taguy M’Fah Traoré. *** Diffusions vers toutes cibles les dimanches à 08h10 TU et 22h10 TU (Heure de Paris = TU + 1 en hiver).
Alle episoder
24 EpisoderLes Béninois face à leurs historiens
Á quoi ressemblait l’Afrique militaire avant la colonisation ? Quels sont les liens entre le continent africain et Haïti ? A-t-on toujours besoin d’appui extérieur pour raconter l’histoire africaine ? À l’occasion de la Black History Week 2026, Elgas a réuni sur son plateau des acteurs de la société béninoise et des historiens pour un échange direct. Avec la participation de l’historien béninois Dieudonné Gnammankou et de Sylvestre Edjekpoto, historien et directeur de l'institut Afrique décide [https://afriquedecide.org/]. POUR ALLER PLUS LOIN UN DIALOGUE FRANC AUTOUR DE LA MÉMOIRE À OUIDAH À l’occasion de la Black History Week, inspirée de la Black History Month, l’émission Afrique, mémoires d’un continent s’est installée à Ouidah, à l’Institut Afrique Décide. L’objectif : ouvrir un dialogue direct entre historiens et citoyens sur la mémoire de l’esclavage [https://www.rfi.fr/fr/tag/esclavage/] et l’histoire africaine. Dans un contexte marqué par la défiance, les récits falsifiés et le sentiment d’une histoire confisquée, deux historiens béninois, Dieudonné Gnammancou et Sylvestre Edjekpoto ont répondu sans tabou aux questions du public. Les interventions révèlent un malaise partagé : beaucoup estiment que l’histoire africaine est insuffisamment enseignée, mal diffusée ou peu accessible. Pourtant, des travaux majeurs existent, notamment l’Histoire générale de l’Afrique publiée par l’UNESCO [https://www.rfi.fr/fr/tag/unesco/] depuis les années 1970. Le problème réside moins dans l’absence de recherche que dans sa vulgarisation, son financement et son intégration dans les programmes scolaires. Les historiens plaident pour une meilleure accessibilité : traductions en langues nationales, documentaires, albums pour enfants, émissions radios et valorisation des noms de rue comme supports de transmission. La discussion aborde aussi l’origine du royaume du Dahomey, la réhabilitation des figures oubliées et des résistances africaines, ainsi que la nécessité d’écrire une histoire générale du Bénin par les historiens béninois eux-mêmes. MÉMOIRE, RÉPARATION ET ENJEUX CONTEMPORAINS Le débat s’élargit aux polémiques persistantes sur l’esclavage et la colonisation. Face aux discours révisionnistes ou aux tentatives de minimisation des crimes, les historiens évoquent la question centrale de l’impunité. L’esclavage et la colonisation, qualifiés de crimes contre l’humanité, n’ont pas fait l’objet de véritables sanctions ni de réparations. Tant que ces questions ne seront pas pleinement reconnues et traitées, elles continueront de susciter tensions et controverses. Enfin, la question du tourisme mémoriel à Ouidah est abordée. Peut-on transformer des lieux de souffrance en espaces touristiques ? Les intervenants défendent l’idée d’un tourisme de reconnexion et de vérité, visant à réunir des peuples séparés par l’histoire. Le futur Musée international de la mémoire et de l’esclavage entend d’ailleurs mettre en avant non seulement la traite négrière, mais aussi l’Afrique d’avant l’esclavage, afin de restaurer la dignité historique des sociétés africaines.
Biafra : au Nigeria, la famine, la guerre et la mémoire
Près de deux millions de morts, par les balles, les armes blanches et la famine. Des enfants au corps rachitique, captés par les photographes du monde entier, clichés qui deviendront les mascottes d'une Afrique peinte sous le jour du malheur. Si la guerre du Biafra n'opère plus vraiment, glissant doucement au fil des décennies vers l'oubli, sa charge, elle, reste douloureuse. POUR ALLER PLUS LOIN LA GUERRE DU BIAFRA : UNE MÉMOIRE DOULOUREUSE À la fin des années 1960, le Nigeria est plongé dans l’une des guerres civiles les plus meurtrières du continent africain : la guerre du Biafra. Ce conflit, marqué par des violences extrêmes, la famine et la mort de près de deux millions de personnes, a profondément fracturé le pays et laissé une trace durable dans la mémoire collective. Les images d’enfants affamés, diffusées dans le monde entier, ont façonné une représentation tragique de l’Afrique et révélé l’ampleur du drame humain. LES RACINES D’UN CONFLIT COMPLEXE Pour comprendre le Biafra, il faut revenir à l’histoire du Nigeria, un État issu de la colonisation britannique, construit sur des divisions ethniques, religieuses et géographiques. Entre un Nord majoritairement musulman et un Sud plus chrétien et animiste, les tensions se sont accentuées après l’indépendance de 1960. Les rivalités politiques, les inégalités économiques et la convoitise des ressources pétrolières ont nourri un climat d’instabilité, menant aux coups d’État militaires et à la sécession de la région orientale en 1967. UNE TRAGÉDIE AUX DIMENSIONS INTERNATIONALES La guerre du Biafra dépasse rapidement le cadre nigérian : elle devient un enjeu international, impliquant des puissances étrangères et suscitant une mobilisation humanitaire mondiale. Entre interventions militaires, rivalités coloniales et médiatisation massive, le conflit révèle les contradictions de l’ordre postcolonial. Si le Nigeria est finalement réunifié en 1970, le traumatisme du Biafra demeure, rappelant les dangers des divisions et l’importance de la mémoire pour prévenir de nouvelles tragédies. Choix musical : « Uso Ndu [https://youtu.be/q4ivvNYYXmA?si=SonxVyFe8kZ1MuxS] », de Celestine Ukwu À lire également : « L'autre moitié du soleil », de Chimamanda Ngozi Adichie.
De Carthage à 1830, la Tunisie au fil des influences
Direction le nord de l’Afrique pour raconter la Tunisie, de Carthage à 1830. Une histoire fascinante pour avoir abrité dominations romaine, arabe, ottomane ou encore française, faite de bouleversements, de rebondissements, de guerres, de traités de paix. Comment ce petit pays, à la géographie singulière, a-t-il façonné ses identités ? De quelles façons sa morphologie, sa position et ses caractéristiques expliquent-elles son histoire ? Avec la participation de l’historienne Sophie Bessis, autrice de « Histoire de la Tunisie : de Carthage à nos jours [https://www.tallandier.com/livre/histoire-de-la-tunisie-2/] » (éd. Tallandier). POUR EN SAVOIR PLUS : UNE HISTOIRE FAÇONNÉE PAR LA GÉOGRAPHIE ET LES CONQUÊTES La Tunisie possède une histoire d’une grande richesse, marquée par des conquêtes, des résistances et des influences multiples. Sa position géographique, à la pointe nord-est de l’Afrique et au cœur de la Méditerranée, en fait un espace ouvert sur l’extérieur. Cette situation explique la succession de dominations – phénicienne, romaine, arabe, ottomane et française – qui ont profondément façonné ses identités. Plus qu’une « exception », Sophie Bessis préfère parler de singularité tunisienne, construite dans le temps long, sans référence à une norme universelle. CARTHAGE ET L’ANTIQUITÉ : UN HÉRITAGE FONDATEUR Carthage, fondée dans le cadre de l’expansion phénicienne, devient une grande puissance maritime et commerciale. Sa civilisation punique résulte d’un mélange entre apports phéniciens et populations berbères locales. Malgré sa puissance, Carthage entre en conflit avec Rome lors des guerres puniques, dont la figure emblématique est Hannibal. Battue définitivement en 146 av. J.-C., Carthage est détruite, mais son héritage perdure dans l’Afrique romaine, fortement urbanisée, prospère et christianisée, donnant naissance à de grandes figures comme Saint Augustin. DE L’ISLAMISATION À LA TUNISIE CONTEMPORAINE La conquête arabe, plus lente qu’en Orient, s’explique par la fragmentation politique du Maghreb et les résistances berbères. L’islamisation ne s’accompagne pas immédiatement de l’arabisation, qui s’intensifie surtout à partir du XIè siècle. Des villes comme Kairouan et Tunis deviennent des centres majeurs. La Tunisie connaît ensuite des dynasties musulmanes, puis l’intégration à l’Empire ottoman sous la régence de Tunis. L’histoire tunisienne apparaît ainsi comme un « millefeuille » de strates culturelles, dont les héritages multiples continuent de façonner la Tunisie d’aujourd’hui.
L’Afrique au cœur de l’âme haïtienne
La mémoire du continent met en miroir deux histoires, deux trajectoires, pour tenter de comprendre les liens entre Haïti et l’Afrique. L’île des Caraïbes entretient avec le continent une relation fondée sur l’héritage historique et identitaire. La société haïtienne est issue en grande partie de populations africaines déportées pendant l’esclavage, et cette origine se reflète dans les valeurs, les croyances et les pratiques culturelles du pays. L’indépendance d’Haïti en 1804 a aussi eu une portée symbolique pour l’Afrique, en ouvrant la voie à l’émancipation, en inspirant les luttes contre la colonisation et l’esclavage [https://www.rfi.fr/fr/tag/esclavage/]. Aujourd’hui, ces liens se manifestent par des échanges culturels, académiques, politiques et diplomatiques, mais également par un sentiment de parenté historique. Avec la participation de : - Philomé Robert, journaliste et écrivain, auteur de « Port-au-Prince Cotonou, un écho sans retour [https://www.caraibeditions.fr/romans-en-francais/782-port-au-prince-cotonou-un-echo-sans-retour.html] » (Caraïbéditions) - Céline Labrune-Badiane, historienne et co-autrice de « Les hussards noirs de la colonie [https://www.karthala.com/accueil/3235-les-hussards-noirs-de-la-colonie-instituteurs-africaines-et-petites-patries-en-aof-1913-1960-9782811119171.html] » (éd. Karthala). POUR EN SAVOIR PLUS : Cette émission met en parallèle deux trajectoires historiques et culturelles pour éclairer la profondeur des relations entre Haïti et l’Afrique. Née de l’esclavage et de la déportation, cette relation est à la fois charnelle, spirituelle et historique. Haïti, première République noire indépendante en 1804, s’est imposée comme un symbole universel de lutte et d’émancipation, tout en conservant en son sein de puissants héritages africains transmis par les captifs : croyances, valeurs, cultures et résistances. CIRCULATIONS INTELLECTUELLES ET DIASPORAS HAÏTIENNES EN AFRIQUE À partir de la fin du XIXᵉ siècle, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, des intellectuels, artistes et professionnels haïtiens migrent vers l’Afrique, notamment lors des indépendances. Cette dynamique s’intensifie sous la dictature de Duvalier, qui pousse de nombreuses élites à l’exil. Des figures majeures comme Jean Price-Mars jouent un rôle central dans l’émergence de la négritude, que Senghor [https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211229-léopold-sédar-senghor-l-homme-des-deux-mondes] reconnaît comme ayant pris racine à Haïti. Les Haïtiens contribuent alors activement à la construction des nouveaux États africains, en particulier au Sénégal, au Bénin et au Congo, dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la médecine et des arts. SPIRITUALITÉ, MÉMOIRE ET AVENIR DU LIEN AFRO-HAÏTIEN Le vaudou [https://www.rfi.fr/fr/podcasts/religions-du-monde/20241108-vaudou-haïtien-des-origines-africaines-au-syncrétisme-multiple-au-delà-des-zombis] incarne l’un des liens les plus profonds entre Haïti et l’Afrique, survivance spirituelle et matrice de la révolution haïtienne. Cette continuité nourrit un sentiment de retour symbolique ou réel vers la terre des ancêtres, comme en témoigne le roman de Philomé Robert. Malgré des tentatives diplomatiques inabouties, notamment avec l’Union africaine, le lien reste vivant. Pour les intervenants, l’histoire entre Haïti et l’Afrique n’est pas achevée : elle demeure ouverte, à réinventer à travers la culture, la mémoire et de nouvelles formes de coopération.
Noirs d’Europe : cinq siècles de présence et d’histoire
Avec son invité, l’historien Dieudonné Gnammancou, Elgas retrace les courants qui ont dispersé les Africains dans le monde, et plus particulièrement en Europe, pour former cette diaspora noire dont le profil démographique évolue à travers les siècles. Les représentations, œuvres d’art, pièces de monnaie, vases, entres autres, témoignent d’une histoire longue. Les Égyptiens furent ainsi les premiers peuples africains à entretenir des relations avec les Grecs, avec des influences mutuelles. Au fil du temps, cette présence se fera aussi par les soldats, dans l’expansion musulmane en Espagne et sa péninsule ibérique dès le VIIème siècle. Et voici donc ouverts les chemins que les traites et l’esclavage agrandiront. Avec la participation de l’historien Dieudonné Gnammankou, enseignant à l’Université Abomey-Calavi au Bénin et auteur de « Abraham Hanibal: l'aïeul noir de Pouchkine [https://www.presenceafricaine.com/livres-histoire-politique-afrique-caraibes/776-abraham-hanibal-l-aieul-noi-de-pouckine-9782708706095.html] » (éd. Présence africaine). ********************************************* UNE PRÉSENCE AFRICAINE ANCIENNE ET CONTINUE EN EUROPE L’émission retrace l’histoire longue et méconnue de la présence africaine et noire en Europe, bien antérieure à l’esclavage moderne. Dès l’Antiquité, des Africains sont attestés en Grèce, notamment à partir du XIIIè siècle avant Jésus-Christ. Des œuvres d’art, des textes littéraires et des vestiges archéologiques témoignent de liens étroits entre l’Égypte antique, l’Éthiopie et le monde grec. Ces relations reposaient sur des échanges intellectuels, religieux, militaires et commerciaux, favorisant des circulations humaines et culturelles durables. Des auteurs comme Homère ou Hérodote évoquent cette présence, reconnue et intégrée dans les sociétés antiques, avec des phénomènes de métissage et des rôles sociaux variés. DES RÔLES MULTIPLES : SOLDATS, SAVANTS ET FIGURES DE POUVOIR Au fil des siècles, les Africains en Europe ont occupé des fonctions diverses : soldats lors des guerres antiques et médiévales, intellectuels, artistes, religieux et dirigeants. L’expansion arabo-musulmane à partir du VIIè siècle accélère cette dynamique, notamment en Espagne et en Méditerranée, où des milliers de soldats africains s’installent durablement. Des figures majeures émergent, comme Ziryab à Cordoue ou Juan Latino à Grenade, mais aussi des papes africains, des empereurs romains et des penseurs influents. Cette réalité contredit l’idée réductrice selon laquelle toute présence noire en Europe serait exclusivement liée à l’esclavage [https://www.rfi.fr/fr/tag/esclavage/]. ESCLAVAGE, DIASPORA ET MÉMOIRE CONTEMPORAINE À partir du XVè siècle, la traite négrière atlantique marque un tournant majeur et transforme profondément le regard européen sur l’Afrique et les Africains. Si l’esclavage explique une partie des flux, il ne résume pas l’histoire des diasporas africaines en Europe. Des relations diplomatiques, éducatives et politiques persistent, comme l’illustrent les parcours d’élites africaines envoyées dans les cours européennes.
Velg abonnementet ditt
Premium
20 timer lydbøker
Eksklusive podkaster
Gratis podkaster
Avslutt når som helst
Prøv gratis i 14 dager
Deretter 99 kr / måned
Premium Plus
100 timer lydbøker
Eksklusive podkaster
Gratis podkaster
Avslutt når som helst
Prøv gratis i 14 dager
Deretter 169 kr / måned
Prøv gratis i 14 dager. 99 kr / Måned etter prøveperioden. Avslutt når som helst.